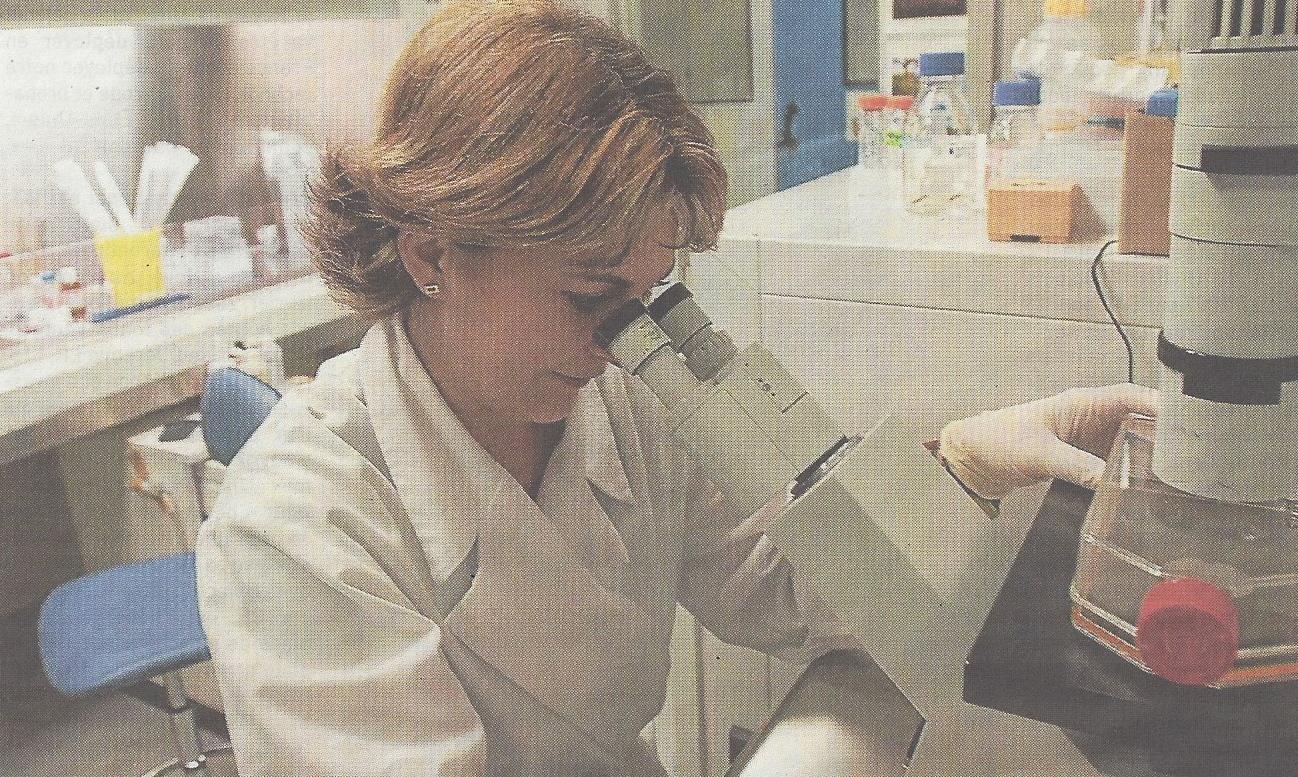Tous les pays du monde se posent la même question : comment améliorer à moindre coût nos systèmes de santé ? Une partie de la réponse viendra des pays du Sud, où les scientifiques sont davantage ouverts aux innovations de rupture et ont appris à faire plus avec moins.
Tous les pays du monde se posent la même question : comment améliorer à moindre coût nos systèmes de santé ? Une partie de la réponse viendra des pays du Sud, où les scientifiques sont davantage ouverts aux innovations de rupture et ont appris à faire plus avec moins.
La santé est le premier secteur d’activité au monde, avec un poids égal à trois fois celui du secteur bancaire. Mais, dans la quasi-totalité des pays, il est loin d’engager la transformation en profondeur à laquelle il ne pourra échapper. Car, malgré les progrès considérables de la médecine, les patients ne sont pas toujours bien soignés, faute de systèmes de santé garantissant des traitements efficaces à un coût abordable.
Tous les pays sont confrontés aux mêmes problèmes. D’une part, une explosion des classes moyennes, qui veulent avoir accès à des soins de qualité, des dépenses de santé qui flambent et des personnes âgées qui vivent plus longtemps. D’autre part, des gouvernements qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour augmenter les budgets affectés à la santé. Impasse totale à l’échelle mondiale…
Stimuler l’innovation de rupture
Seule l’innovation peut aider à relever ces défis. Il faut non seulement innover de façon disruptive en matière de science, de technologie et de pratique médicale, mais il faut aussi et surtout accélérer la cadence de l’innovation. Parmi les diverses approches qui stimulent l’innovation de rupture, l’innovation inversée apparaît comme l’une des plus prometteuses lorsqu’il s’agit de la santé.
L’Afrique peut-elle continuer sa course en avant ?
Le terme caractérise une innovation qui est d’abord conçue pour des pays en développement, où elle est utilisée avant de se propager dans les pays développés. Le coût en est le moteur – les Indiens parlent d’innovation frugale. C’est en ce sens que l’innovation inversée, qui permet de faire plus avec moins, pourrait aider les pays du Nord à soigner à moindre coût, plus efficacement. Mais ce n’est pas seulement une question de coût.
L’innovation inversée est aussi une vraie source de progrès. Pour pallier le manque de ressources et d’infrastructures, les pays en développement ont sauté l’étape de la téléphonie fixe et des combustibles fossiles pour passer directement à la téléphonie mobile et à l’énergie solaire. Les scientifiques de ces pays ne se laissent pas enfermer dans des façons de penser et de faire rigides et immuables. Ils sont davantage prédisposés aux innovations de rupture et sont plus enclins à faire des bonds technologiques. Ils inventent par nécessité.
7 exemples d’innovation inversée
Voici sept exemples récents d’innovation inversée dans le domaine de la santé :
– L’Himalayan Cataract Project, initiative née au Népal, a permis pour seulement 20 dollars de restaurer la vue à 4 millions de patients atteints de cataracte dans 24 pays.
– Le Cardiopad , une tablette tactile qui vient du Cameroun, permet d’effectuer en moins d’une demi-heure des examens cardiaques dans des zones rurales reculées et de transmettre immédiatement les résultats à un réseau de cardiologues.
– Practo, une plate-forme réunissant quelque 200.000 médecins et 10.000 hôpitaux. Les 25 millions de patients qui y recourent chaque année en Inde peuvent prendre, changer et annuler un rendez-vous avec des médecins généralistes ou spécialistes et peuvent payer leur consultation en ligne à tout moment, et de n’importe où.
– Zipline , une start-up dont les drones peuvent effectuer entre 50 et 150 vols par jour pour fournir en urgence à des cliniques rwandaises des poches de sang destinées à des transfusions qui ont déjà sauvé 6 millions de vies.
– 3nethra, un appareil d’imagerie ophtalmologique portable, peu coûteux et non invasif mis au point par la start-up indienne Forus Health. Il dépiste les cinq affections oculaires qui sont les principales causes de cécité.
– Sense Ebola Followup , une application mobile de localisation par GPS qui réduit de soixante-douze à seulement deux heures le délai entre l’identification d’un cas suspect d’Ebola et la confirmation de contamination. Cette invention a contribué, avec une efficacité inégalée, à la lutte pour éradiquer le virus Ebola au Nigeria, en Sierra Leone et en Guinée.
– Enfin, les Accompagnateurs, des auxiliaires de santé qui sont issus du même cadre de vie que les patients et qui sont recrutés, formés et rémunérés pour les accompagner vers la guérison. Ce système d’agents de santé communautaires a été mis en place d’abord en Haïti, au Rwanda ou au Mexique, puis dans les quartiers démunis de Boston, où il a permis de réduire les dépenses d’hospitalisation de près de deux tiers et les coûts de traitement de 36 %.
Les pays en développement à la pointe de l’innovation
Il est certain qu’un nombre croissant d’innovations disruptives viendront d’Afrique et de toutes les économies émergentes sur des sujets primordiaux tels que la prévention, la nutrition, l’accès équitable et sûr aux médicaments, la télémédecine et le dépistage rapide des maladies infectieuses. A nous d’exploiter toute la richesse et la diversité de ces avancées.
Santé numérique : les technologies peu élaborées valent mieux que les innovations sophistiquées
Une partie du travail à accomplir dans les prochaines années consistera à déterminer comment les pays développés pourraient s’inspirer des innovations provenant de pays en développement afin d’accélérer la transformation de leurs systèmes de santé. Nous sommes face à des défis majeurs. La science seule ne pourra sortir le secteur de la santé de l’impasse. Il est devenu impératif de combler le fossé entre la science, la technologie et la pratique médicale.
Et pour y parvenir, il faudra tirer pleinement parti de toutes les idées novatrices, d’où qu’elles viennent. Les sept exemples d’innovation inversée que j’ai cités offrent un accès plus facile aux soins, ce qui est un enjeu crucial pour tous les pays du monde. De plus en plus, le Sud exportera des idées vers le Nord. Le Sud inspirera le Nord.
Jean-Marie Dru est président de l’Unicef France et de la Fondation de l’Académie de médecine.
Source Les Echos – 21/08/2017